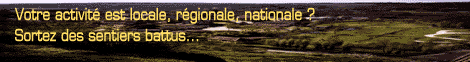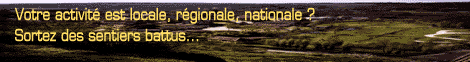Sommaire
AVANT PROPOS
L'eau fait parler d'elle quand elle pose problème: sécheresse qui entraîne des coupures d'eau ou limite ses usages, pollution des rivières qui charrient des centaines de tonnes de poissons morts, inondations avec leur cortège de malheurs et de désolation et entre temps, lorsqu'aucun fléau n'est à déplorer, cherté de l'eau.
"Quand le puits est à sec, on sait ce que vaut l'eau", dit le proverbe. Quand on peut y puiser, on ne regarde plus au nombre de seaux retirés. L'eau est gratuite, jusqu'au jour où ....
Le prix de l'eau est la mémoire de ces phénomènes, c'est à dire de la vie avec sa complexité, ses merveilles et ses événements tragiques. L'eau est le plus magique des éléments, mais comme elle intervient pour tout et partout, elle finit par réclamer son dû au passage. Oh, très peu de choses par rapport à d'autres choix économiques collectifs ou personnels, certainement plus futiles, voire inutiles. Mais la vie est ainsi perçue : c'est un don. A elle la gratuité, l'insouciance, et parfois même l'ingratitude. Et comme l'eau c'est précisément la vie, il en va sans doute de même.
Payer l'eau son juste prix n'est pas seulement une attitude civique, c'est une valeur. C'est une relation philosophique avec soi-même, un rapport d'existence avec les autres. Les pages qui suivent s'attachent à nous en faire la démonstration avec simplicité et limpidité.
Chose chère est bon marché.
Pierre Frédéric Ténière Buchot
Professeur associé au Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris, [Ancien, ndlr] Directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
INTRODUCTION
Que d'affirmations fausses et que de controverses sur le prix de l'eau ! Il est vrai qu'il est difficile d'y voir clair. Entre les nouvelles réglementations qui mettent notre facture en ébullition, l'ambiguïté des termes généralement utilisés, et le manque global de transparence qui entoure ce sujet, il y a de quoi y perdre son latin !
Cet ouvrage se veut au contraire simple, informatif... et limpide ! L'élu et le citoyen de base y trouveront donc réponse à nombre des questions qu'ils se posent.
Côté contenu, l'objectif de ce livre est de donner les outils nécessaires pour décrypter la situation et agir. D'où son programme. L'analyse de ce qui se passe derrière notre robinet passe par la découverte de l'ensemble des nouveaux textes de loi qui concernent l'eau, de façon directe ou indirecte. Quant à l'action, elle suppose de savoir qui est responsable de quoi, quels partenaires institutionnels et financiers solliciter, quels choix techniques privilégier. Elle demande également d'adopter une stratégie, tant du point de vue économique que de celui de la communication. C'est en effet sur ce dernier chapitre, souvent fort délaissé, que se cristallisent les problèmes qui opposent un élu à sa population, en matière de prix de l'eau ! Enfin il est indispensable de connaître les bonnes adresses.
Précisons que le sujet traité ici n'est pas l'eau dans sa globalité, mais uniquement l'eau du robinet et son devenir, bref ce que la facture d'eau rétribue. L'aménagement des rivières et autres interventions sur le milieu aquatique sont financés par le biais des impôts.
Côté forme, ce livre se veut accessible à tous. Pas question ici d'utiliser le jargon du spécialiste, même pour donner les informations les plus pointues. A cela, deux raisons : souci démocratique, tout d'abord, mais aussi souci d'efficacité. Ceux à qui l'élu doit rendre compte de ses décisions à propos du prix de l'eau n'ont aucune connaissance technique, et l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils acquièrent le vocabulaire du professionnel avant de comprendre !
Dans cette optique, nous nous sommes attachés à utiliser systématiquement les termes au sens où l'emploie le simple quidam: dans les pages qui suivent, le prix de l'eau renvoie par exemple tout bêtement au montant total de la facture.
L'auteur espère ainsi persuader ses lecteurs que l'eau est un bien précieux : sous?estimer cette valeur aujourd'hui risquerait d'en faire l'or de demain.
Pour faire tomber à l'eau quelques idées reçues
Dispenser l'eau au robinet suppose tout une organisation sociale et technique. Mais celle?ci est d'autant plus ignorée que les équipements nécessaires à la bonne gestion de ce bien commun sont généralement enterrés ou mis à distance. Ce phénomène a engendré beaucoup d'idées fausses. Ce premier chapitre s'attache à clarifier la situation.
1. L'EAU EST GRATUITE
"Payer l'eau" : l'expression a de quoi scandaliser. Peuton imaginer de facturer au citoyen l'air qu'il respire, ou la lumière du soleil au dehors ? Cela déclencherait probablement de belles manifestations populaires...
Heureusement, il n'est pas plus question d'acheter (ou de vendre) l'eau disponible au robinet que l'un quelconque des éléments nécessaires à notre survie. C'est seulement l'ensemble des activités sous?jacentes que la facture rémunère, c'est?à?dire tous les travaux nécessaires pour la trouver, la capter, la pomper, la purifier, la transporter jusqu'aux habitations... puis la récupérer, la nettoyer de ses salissures domestiques, et enfin la rendre au milieu naturel.
S'approvisionner dans une rivière ou un puits est gratuit... Mais il est bien rare (et de plus en plus rare) que cette eau soit potable, aussi transparente soit-elle !
2. DERRIERE L'EAU COURANTE, UN PATRIMOINE COLOSSAL
Sources : Union des industries de l'Eau et de l'Environnement (UIE) et
Institut français de l'Environnement (IFEN)
La population française est alimentée en eau potable à 98 %. Cette réalité se traduit en amont des habitations par quelque 560 000 km de canalisations, 120 000 km de branchements et plus de 3 000 unités de potabilisation. En outre, environ 40 000 réservoirs permettent le stockage du volume consommé en France pendant une journée. Ce patrimoine gigantesque est évalué à 425 milliards de francs (valeur 95). Or non seulement il a fallu le payer, mais il faut l'entretenir.
Le taux des logements desservis par un réseau d'assainissement dans l'hexagone est quant à lui estimé à 82,5 % (valeur 94). Les canalisations correspondantes totalisent environ 160 000 km. Elles aboutissent à plus de 12 000 stations d'épuration collectives. Ce second patrimoine (réseau et stations) est estimé à environ 187 milliards de francs.
Quelques sommes
En juin 95, l'Union des industries de l'Eau et de l'Environnement (UIE) s'est intéressée à 40 chantiers d'assainissement réalisés dans des communes de 2 000 habitants au plus. Sur les cas observés, il ressort que le coût moyen du mètre linéaire de canalisation (tous diamètres confondus) est d'environ 865 F HT, et que le coût moyen de la portion de réseau nécessaire pour collecter les eaux sales d'une habitation est de l'ordre de 27 000 F HT. La station d'épuration est en sus.
De son côté, le laboratoire Gestion des services publics(1) estime que l'équipement nécessaire pour épurer de façon autonome les eaux usées d'un foyer de 4 personnes atteint, en moyenne, un montant équivalent (hors contraintes exceptionnelles).
En 92, le Cercle français de l'eau(2) situait quant à lui l'investissement à faire, pour avoir l'eau courante, dans une fourchette de 15 000 F à 20 000 F par foyer, en moyenne.
1. Laboratoire de recherche économique, commun à l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'Agriculture et de l'Environnement (Cemagref) et à l'Ecole nationale du génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES).
2. Association regroupant des associations nationales d'élus, des groupements professionnels de l'eau et des institutions.
|
Fournir de l'eau potable est de la responsabilité des communes ou de leurs regroupements, tout comme évacuer et épurer les eaux usées, parce que ces activités sont par nature locales : on prélève le liquide à potabiliser au plus près d'où l'on en a besoin, et on transporte les eaux sales, puis épurées, le moins loin possible.
Aujourd'hui, les consommateurs sont vigilants.
Longtemps à l'abri de toute condamnation, les maires sont de plus en plus dans le collimateur des consommateurs et des écologistes. Trois élus bretons se sont par exemple vus condamner, en 1994, pour n'avoir pas fait remédier au dysfonctionnement de leur station d'épuration.
Côté eau potable, les maires et présidents de groupements intercommunaux sont encore assez peu inquiétés. Mais la présence de germes pathogènes dans l'eau distribuée et une vigilance accrue des consommateurs pourraient bientôt les exposer à de sérieux problèmes (voir encadré). Ne pas réagir vis?à?vis des sources de pollutions susceptibles de polluer leurs propres captages risque de leur coûter cher. Rappelons que sauf exception, un maire n'est pas tenu d'installer l'eau courante dans sa commune, mais qu'il doit la fournir potable, dès lors que cette desserte existe.
Législation en vigueur et condamnation d'élus
L'eau potable, source de condamnation
Les élus ne sont pas à l'abri derrière leur statut ! Les dispositions du code pénal concernant les délits d'homicide et de blessure involontaire s'appliquent dans le domaine de l'eau comme dans les autres. C'est pourquoi un maire ou un président de groupement intercommunal peuvent être condamnés à ce titre, ainsi que la commune ou le regroupement concernés, en tant que personne morale. Le cas peut notamment se présenter, si des consommateurs apportent la preuve qu'avoir bu de l'eau du robinet les a rendu malades, ou a provoqué la mort de quelqu'un. Cette disposition pénale concerne en tout premier lieu les responsables de la pollution à l'origine du problème, mais la responsabilité pénale des élus et personnes morales précitées peut également être recherchée, si les dommages constatés relèvent aussi de leur négligence.
La pollution peut, elle aussi, être pénalisante
Côté délits de pollution, les tribunaux suivent des principes analogues. Un élu peut être condamné personnellement par les tribunaux pénaux pour avoir contaminé une zone de baignade ou perturbé un service de distribution d'eau, en aval de sa commune (loi sur l'eau du 3 janvier 1992, article 22). II peut l'être également pour avoir décimé la faune ou la flore piscicole (infraction définie dans une ordonnance de 1959, reprise dans le code rural, article L 232-2). La loi Barnier du 2 février 1995 a, quant à elle, permis d'élargir cette condamnation à la commune, en tant que personne morale, lorsque la responsabilité personnelle du maire est ténue ou mal établie.
|
Les assemblées qui prennent les décisions au sein des communes ou des groupements de communes responsables d'un service d'eau (distribution d'eau potable ou assainissement) ont un poids déterminant dans le montant de la facture. Elles ne fixent toutefois que deux composantes du prix total payé par tout un chacun pour son eau au robinet, et dans bien des cas, après négociation avec des sociétés privées très puissantes (voir chapitre V).
L'une de ces composantes est la redevance du service d'eau potable : ajouté à des subventions complémentaires éventuelles, son montant finance l'ensemble du budget nécessaire pour assurer la distribution de l'eau potable aux usagers. L'autre est la redevance d'assainissement : comme son nom l'indique, elle alimente, subventions à l'appui, le budget qui permet d'assurer le service collectif d'assainissement (collecte des eaux usées et station d'épuration). En conséquence, seuls les habitants desservis par un réseau d'égout doivent régler cette seconde somme.
Ces deux redevances représentent en général la partie la plus importante du montant total du prix de l'eau. Mais celui-ci réunit également tout un ensemble d'autres rémunérations. Ces sommes sont décrites au 5.3. et 5.4. du présent chapitre.
5. LE PRIX DE L'EAU EST UN PUZZLE
En général, les particuliers reçoivent une facture unique, envoyée par le gestionnaire du service de distribution (distributeur). Cet organisme est alors chargé de collecter les différentes composantes de ce montant, et de reverser ensuite la part qui leur correspond aux divers partenaires concernés.
5.1. Sommes perçues au profit des collectivités locales et assimilés
A la commune ou au groupement de communes, autrement dit aux responsables des services d'eau (distribution d'eau potable ou assainissement des eaux usées), reviennent éventuellement des sommes dénommées surtaxe et redevance. C'est le cas lorsque ces instances réalisent ellesmêmes des investissements dans le cadre de ces services. Ces rentrées d'argent leur permettent alors de couvrir les dépenses correspondantes. Peuvent s'y ajouter des montants complémentaires, pour alimenter un budget information aux consommateurs par exemple.
5.2. Sommes perçues au profit du gestionnaire du service
Le gestionnaire du service de distribution (distributeur d'eau) et le gestionnaire du service d'assainissement peuvent être la commune ou les regroupements de communes eux-mêmes. Dans la négative, ce sont des sociétés privées.
Le distributeur récupère deux sommes. L'une représente une partie des frais fixes de gestion, et éventuellement la location du compteur d'eau. L'autre est déterminée en fonction de la quantité d'eau consommée. Elle finance les coûts d'exploitation : main-d'oeuvre, électricité... bref toutes les dépenses nécessaires pour pomper, traiter, stocker, et faire arriver l'eau au robinet, en dehors des équipements.
Si le distributeur est une société privée et qu'il est chargé de réaliser les investissements, c'est à lui qu'échoit l'équivalent de la surtaxe mentionnée plus haut.
Quant au gestionnaire du service d'assainissement, il empoche lui aussi la part qui couvre ses dépenses d'exploitation : un montant répercuté sur les factures, en fonction de la consommation d'eau. Lorsque ce gestionnaire est une société privée, et qu'il est chargé de construire les ouvrages, c'est lui qui encaisse la redevance correspondante, mentionnée au 5.1.
5.3. Sommes perçues au profit d'établissements publics
L'Agence de l'eau locale est un établissement public qui redistribue ce qu'il perçoit, à la façon d'une mutuelle. Il récupère deux redevances. L'une s'appelle redevance pour prélèvement et consommation d'eau, l'autre, redevance pour pollution. Ces deux sommes alimentent des budgets de subventions ou de prêts à taux nul ou très faible, destinés à aider les propriétaires d'ouvrages (maîtres d'ouvrages). Objectif : assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau, pour tous ces usages, et protéger cette eau contre les pollutions de toutes natures.
Une petite part de la facture d'eau revient à un second établissement public, dénommé Voies navigables de France (VNF), si les captages d'eau ou les rejets après épuration sont effectués dans des voies fluviales (cours d'eau ou canaux) officiellement considérées comme navigables.
5.4. Sommes perçues au profit de l'Etat
L'Etat touche une redevance et une taxe. La première sert à aider les communes rurales à financer leurs travaux d'alimentation en eau potable et leurs travaux d'assainissement. Elle alimente pour ce faire un budget appelé fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE). La seconde est la TVA, facturée au taux réduit de 5,5 % sur tout ou partie des sommes énoncées précédemment, selon les choix de gestion, les choix fiscaux et la taille des communes concernées. Précisons que la Corse et les DOM TOM sont privilégiés en la matière, avec un taux encore plus réduit, soit 2,10 %.
6. LE PRIX DE L'EAU N'EXISTE PAS !
Contrairement à l'essence ou au pain, le prix de l'eau dépend des niveaux de consommation. En général, il est facturé moins cher au-delà de certains volumes. Suivant les communes, il comprend des tranches à prix constant, des tranches où le tarif est proportionnel au volume consommé, un abonnement ou pas... La seule pratique exclue est celle du forfait intégral (sauf dérogation expresse !)... D'où l'importance d'effectuer des comparaisons de prix, à consommations égales.
Une pluie de tarifications !
Le ministère chargé de l'Agriculture a recensé 15 200 distributeurs d'eau en France, ce qui entraîne l'existence d'au moins 15 200 tarifications différentes ! D'après le ministère chargé de la Santé, la moitié de ces unités de distribution desservent des communes d'au plus 500 habitants (données 1995).
|
D'après les statistiques du ministère de l'Environnement, la facture d'eau atteignait en moyenne 14 F TTC par m
3 dans l'hexagone, au premier semestre 95. Ces calculs ont été effectués en référence à une consommation de 120 m
3 par an, volume qui correspond, selon l'INSEE, à la consommation (elle aussi) moyenne d'un ménage français. Ils traduisent les proportions (toujours moyennes !) suivantes :